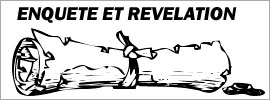Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire ?
Quand j’étais enfant, j’adorais lire, notamment parce que je voyageais énormément et qu’il m’arrivait de me sentir décalé, étranger là où j’étais. A mon arrivée en Indonésie (1), j’étais un grand gamin à la peau sombre, j’avais tendance à détonner. Et au moment de quitter ce pays pour rentrer à Hawaï, j’avais probablement les manières et les habitudes d’un petit Indonésien.
C’est pour cela que l’idée de posséder ces univers portatifs, des mondes qui m’appartenaient et dans lesquels je pouvais m’immerger, me plaisait tant. Et puis je suis devenu adolescent et je ne lisais plus grand-chose d’autre que ce qui était imposé à l’école, je jouais au basket et je courais après les filles, et j’ingurgitais des trucs pas très bons pour la santé.
Je crois qu’on a tous fait ça.
Oh oui ! Et puis j’ai redécouvert l’écriture, la lecture et la pensée ; je crois que c’était en première ou en deuxième année d’université. Je m’en suis alors servi comme d’un outil pour me réinventer, un processus que je décris dans Les Rêves de mon père (2).
S’agit-il de cette période à New York, au cours de laquelle vous lisiez de façon intensive ?
J’étais complètement replié sur moi-même – c’est la stricte vérité. Je n’avais qu’une seule assiette, une seule serviette, et j’achetais mes vêtements dans les friperies. J’étais quelqu’un de très passionné, relativement dénué d’humour. Mais cela m’a permis de redécouvrir le pouvoir des mots pour comprendre qui j’étais, ce que je pensais, ce en quoi je croyais, et ce qui comptait vraiment pour moi. C’était aussi un moyen de m’y retrouver, de parvenir à interpréter le tourbillon d’événements qui s’enchaînent autour de nous à chaque instant.
Lorsque j’ai obtenu mon diplôme, j’ai décidé que je voulais m’impliquer dans la vie publique. Disons que j’avais de vagues notions de ce que pouvait être l’organisation communautaire… Mais l’idée de continuer à écrire et à raconter des histoires, est restée très importante pour moi. Quand je rentrais du travail, je prenais des notes dans mon journal, ou j’écrivais une histoire ou deux. Cela m’a beaucoup servi dans mon travail communautaire.
Quand j’ai commencé, le type qui m’a engagé m’a expliqué que ce qui donne aux gens le courage de se rassembler pour agir et prendre leurs vies en main, ce n’était pas seulement le fait d’avoir un problème en commun, mais le fait d’avoir des histoires en partage. C’est lui qui m’a dit que, pour être capable de tisser des liens durables avec les gens, il faut apprendre à écouter leurs histoires et à déceler ce qu’elles ont de sacré. Par la suite, ma passion pour le service public et la politique a convergé avec mon intérêt pour les histoires.
A quoi ressemblaient vos nouvelles ?
Je remarque une chose intéressante en les relisant: la plupart parlent de personnes âgées. Je crois que c’est dû, entre autres, au fait que je travaillais dans des communautés composées de gens beaucoup plus âgés que moi. Nous allions dans les églises, où la moyenne d’âge devait être de 55 ou 60 ans.
La plupart de ces gens avaient travaillé d’arrache-pied pour se hisser jusqu’à la classe moyenne, et ils y étaient tout juste parvenus. Ils voyaient peu à peu péricliter les communautés dans lesquelles ils avaient investi leurs espoirs et leurs rêves, au sein desquelles ils avaient élevé leurs enfants – les aciéries avaient fermé, la proportion de Noirs et de Blancs avait beaucoup changé dans ces populations. Il régnait un sentiment de perte et de déception.
Une partie des nouvelles que j’ai écrites évoquait donc ce sentiment, cette atmosphère. Il y en a une sur un vieux pasteur noir menacé de perdre son église, car son bail arrive à expiration. Il a auprès de lui une femme diacre qui lui est fidèle et s’efforce de lui redonner courage. Dans une autre nouvelle, il est question d’un couple âgé – des Blancs de Los Angeles. Lui travaillait dans la publicité, il concevait des jingles. Il vient de prendre sa retraite et cela le rend grincheux. Et sa femme essaie de le convaincre que sa vie n’est pas terminée.
Quand je repense aux sujets qui m’intéressaient, ce n’étaient pas tellement les histoires à la Jack Kerouac, avec des jeunes gens avides de découvertes qui prennent la route et partent à l’aventure… Je préférais les histoires mélancoliques, contemplatives.
Est-ce qu’écrire était aussi une façon de mieux saisir votre identité ?
Oui, je crois. Pour moi, à cette époque en particulier, écrire était une manière de m’y retrouver parmi les nombreux courants opposés qui traversaient ma vie – la race, la classe, la famille. Et je crois sincèrement que cela m’a aidé à intégrer tous les aspects de ce que je suis pour former un tout relativement cohérent.
On me décrit souvent aujourd’hui comme quelqu’un de très posé, maître de lui-même. Et c’est vrai que j’ai globalement un sentiment solide d’appartenance, une vision claire de mon identité et de ce qui compte à mes yeux. C’est en grande partie grâce à cette expérience passée de l’écriture.
Avez-vous continué à écrire pendant que vous étiez président ?
Pas autant que je l’aurais souhaité. Je n’avais tout simplement pas le temps.
Mais vous teniez une sorte de journal ?
J’ai tenu des journaux, oui, mais pas avec autant de discipline que je l’aurais espéré. Quand j’étais président, ma principale activité d’écriture, c’était mes discours – du moins ceux qui m’importaient.
Quel impact a eu sur votre façon d’écrire le fait de rédiger des discours, d’être au cœur de l’histoire et de gérer des situations de crise ?
Je n’en suis pas encore sûr. On verra quand je commencerai à écrire le prochain livre. L’art de composer un bon discours est en partie semblable à toute autre entreprise d’écriture littéraire : tel mot est-il nécessaire ? Est-ce le mot juste ? Est-ce que le rythme fonctionne ? Comment cela sonne-t-il à haute voix ?
En fait, je crois que l’écriture de discours est notamment utile pour se rappeler qu’à l’origine les mots se prononcent, qu’ils ont une sonorité, qu’ils procurent des sensations, même quand on les lit en silence. A cet égard, je crois que je trouverai une forme de continuité. Mais c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles c’était important pour moi, quand j’étais président, de lire un roman de temps en temps : parce que l’essentiel de mes lectures quotidiennes était des documents et notes d’information, des textes de projet.
Et faire travailler en permanence la partie la plus analytique du cerveau peut vous amener à perdre de vue non seulement la poésie de la fiction, mais surtout la profondeur de la fiction. Celle-ci m’était utile pour me rappeler les vérités sous-jacentes aux sujets dont nous débattons tous les jours, et c’était une façon de voir et d’entendre les voix, les multitudes de ce pays.
Avez-vous des exemples de romans ou d’écrivains en particulier ?
Le dernier roman que j’ai lu, c’était The Underground Railroad, de Colson Whitehead (3). Ce livre nous rappelle comment la douleur de l’esclavage se transmet de génération en génération, de façon visible mais aussi plus insidieuse, parce qu’elle transforme les cœurs et les esprits.
Vous avez fait référence à Atticus Finch (4) dans votre discours d’adieu, quand vous avez dit que les gens sont isolés dans leur petite bulle.
La fiction peut rapprocher les gens. J’ai entamé une relation amicale avec Marilynne Robinson (5), qui est aujourd’hui une amie proche. Nous sommes en quelque sorte devenus des correspondants. J’ai commencé à lire son œuvre dans l’Iowa, où se déroulent Gilead et quelques-uns de ses meilleurs romans.
Son travail m’a plu parce que je rencontrais tous les jours les gens dont elle parle dans ses fictions. La vie intérieure qu’elle décrivait, que ces gens partageaient – ces gens à qui je serrais la main et à qui j’adressais mes discours –, cette vie intérieure les liait aussi à mes grands-parents, qui étaient du Kansas et ont fini leur vie à Hawaï, mais avaient leurs racines dans un univers très semblable.
Pendant mon mandat, j’ai pu imaginer plus facilement ce qui se passait dans la vie des gens, non pas grâce à un roman en particulier, mais grâce au fait de lire de la fiction. C’est une forme d’entraînement, et je pense qu’elle a été utile. Et puis il y avait parfois des moments où j’avais seulement besoin d’échapper à moi-même. Parfois on lit de la fiction simplement parce qu’on a envie d’être ailleurs.
Avez-vous des exemples de livres de ce genre ?
C’est amusant car finalement pour m’évader je lis toutes sortes de genres littéraires – de la science-fiction, notamment. Pendant un moment, il y avait une trilogie de romans de science-fiction, la série intitulée Le Problème à trois corps (6)…
Oh, de Liu Cixin, qui a gagné le prix Hugo.
C’est d’une imagination folle, très intéressant. Il ne s’agit pas tant d’études de personnages que de cette question fondamentale…
En fait cela parle du destin de l’univers.
Exactement. C’est d’une portée vertigineuse. Et tellement amusant à lire, entre autres parce qu’après cela mes difficultés quotidiennes avec le Congrès paraissaient assez insignifiantes. Pas de quoi s’inquiéter: les extraterrestres sont sur le point de nous envahir. Il y a aussi ces livres qui associent, selon moi, une véritable plume à la littérature de genre, comme le thriller.
Par exemple, je trouve que Les Apparences (7) est un livre bien construit, bien écrit. La structure narrative m’a beaucoup plu. Dans le même genre, en termes de structure, il y a un roman que j’ai trouvé très puissant : Les Furies, de Lauren Groff (8). J’aime bien ces constructions qui vous permettent de découvrir différents points de vue. C’est ce que je devais faire moi aussi dans ce boulot.
Y a-t-il des livres qui sont devenus des références pour vous, au cours de ces huit années ?
Je dirais que Shakespeare reste une référence. Comme la plupart des adolescents au lycée, quand on nous a donné à lire La Tempête, je me suis dit : « Oh mon Dieu, qu’est-ce que c’est ennuyeux ! » Et puis, j’ai suivi un cours formidable sur Shakespeare à l’université, et je me suis mis à lire les tragédies et à approfondir son œuvre. Et je crois que cela a été fondateur pour moi, pour comprendre comment certains comportements se répètent, et ce qui se joue entre les êtres humains.
Est-ce que cela vous rassure, en quelque sorte ?
Cela me permet de mettre les choses en perspective. Je pense aux œuvres de Toni Morrison – Le Chant de Salomon (9) tout particulièrement, un livre qui me vient en tête quand je me représente des gens qui traversent des moments difficiles. Je me dis qu’il ne s’agit pas que de souffrance, mais aussi de joie, de gloire et de mystère. Il y a des écrivains avec lesquels je ne suis pas forcément d’accord sur le plan politique, mais dont les œuvres m’offrent en quelque sorte un contrepoint sur lequel m’appuyer pour penser certains sujets : V.S. Naipaul, par exemple.
Son livre A la courbe du fleuve (10) s’ouvre avec la phrase suivante : « Le monde est ce qu’il est ; les hommes qui ne sont rien, qui s’autorisent à ne rien devenir, n’y ont pas leur place. » Je repense toujours à cette phrase et aux romans de Naipaul quand je médite sur la brutalité du monde, notamment en matière de politique étrangère. Et je résiste, je me bats contre cette vision cynique et réaliste du monde. Et pourtant, il arrive parfois que cette phrase ait des accents de vérité. En ce sens, des textes comme celui-là me servent de repoussoirs, ce sont des points de vue contre lesquels on peut débattre. […]
Avez-vous des livres à recommander en cette période que nous traversons, qui ont su saisir le chaos ambiant ?
C’est probablement à vous que je devrais poser la question. Je dois avouer que depuis les élections, j’ai été plus occupé que je ne m’y attendais. L’une des choses que j’ai vraiment hâte de faire, c’est de me plonger dans quantité de livres. Mais ce dont je suis sûr, c’est qu’il y a un tas d’écrivains, jeunes pour la plupart, qui sont probablement en train de se saisir de ce moment pour écrire le livre que j’ai besoin de lire. Ils ont une longueur d’avance sur moi, aujourd’hui.
Et dans cette période post-présidence, en plus de former la prochaine génération de dirigeants à travailler sur des questions comme le changement climatique, la violence armée ou la réforme du système de justice pénale, j’espère parvenir à créer des liens entre eux et leurs pairs qui considèrent la fiction ou la non-fiction comme un élément important de ce processus.
Alors que l’essentiel de la politique consiste à essayer de gérer le choc des cultures provoqué par la mondialisation, la technologie et les migrations, le rôle des histoires pour unifier plutôt que pour diviser, pour impliquer plutôt que pour marginaliser, est plus crucial que jamais.
Il y a quelque chose d’unique dans le fait de ralentir et de s’accorder un temps long, qui n’est pas celui de la musique, de la télévision ou des films, même les meilleurs. Or de nos jours, nous sommes tous confrontés à une masse d’informations, et nous manquons de temps pour les assimiler. Cela nous conduit à formuler des jugements trop rapides, à traiter les choses de façon stéréotypée ou à en refouler d’autres, simplement parce que notre cerveau fait ce qu’il peut pour tenir le coup. […]
Je sais que vous aimez les livres de Junot Diaz et de Jhumpa Lahiri, qui interrogent les thèmes de l’immigration, ou encore du rêve américain.
Pour moi, leurs romans témoignent en effet d’une forme bien précise d’expérience contemporaine de l’immigration. Mais ils parlent aussi de ce mélange de sentiments que je crois universel : l’aspiration à un avenir meilleur, ailleurs, en même temps que l’impression de ne pas être à sa place, et la nostalgie du passé. En ce sens, je crois que leurs romans entretiennent un lien direct avec une grande partie de ce qui constitue la littérature américaine.
Certains des plus grands livres d’auteurs juifs comme Philip Roth ou Saul Bellow sont pétris de ce sentiment d’être un étranger, de cette aspiration à s’intégrer, sans être certain de ce qu’il faudra abandonner en retour – de ce qu’on est prêt ou pas à abandonner. Cette facette particulière de la fiction américaine est, je crois, toujours d’une grande actualité.
(1) Barack Obama, né en 1961 à Hawaï, a vécu quatre années en Indonésie, pays d’origine de son beau-père, entre 1967 et 1971.
(2) Son autobiographie publiée en 1995.
(3) Publié en 2016 et récompensé par le National Book Award, à paraître le 17 août 2017 chez Albin Michel.
(4) Atticus Finch est l’un des personnages principaux de Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur (1960), de Harper Lee, avocat blanc défenseur de la cause des Noirs.
(5) Romancière née en 1943, auteur entre autres de Gilead (2004) et Chez nous (2009).
(6) Publié en 2016.
(7) Roman de Gillian Flynn publié en 2012 et adapté au cinéma en 2014 par David Fincher.
(8) Publié en 2015.
(9) Publié en 1977.
(10) Publié en 1979
Quand j’étais enfant, j’adorais lire, notamment parce que je voyageais énormément et qu’il m’arrivait de me sentir décalé, étranger là où j’étais. A mon arrivée en Indonésie (1), j’étais un grand gamin à la peau sombre, j’avais tendance à détonner. Et au moment de quitter ce pays pour rentrer à Hawaï, j’avais probablement les manières et les habitudes d’un petit Indonésien.
C’est pour cela que l’idée de posséder ces univers portatifs, des mondes qui m’appartenaient et dans lesquels je pouvais m’immerger, me plaisait tant. Et puis je suis devenu adolescent et je ne lisais plus grand-chose d’autre que ce qui était imposé à l’école, je jouais au basket et je courais après les filles, et j’ingurgitais des trucs pas très bons pour la santé.
Je crois qu’on a tous fait ça.
Oh oui ! Et puis j’ai redécouvert l’écriture, la lecture et la pensée ; je crois que c’était en première ou en deuxième année d’université. Je m’en suis alors servi comme d’un outil pour me réinventer, un processus que je décris dans Les Rêves de mon père (2).
S’agit-il de cette période à New York, au cours de laquelle vous lisiez de façon intensive ?
J’étais complètement replié sur moi-même – c’est la stricte vérité. Je n’avais qu’une seule assiette, une seule serviette, et j’achetais mes vêtements dans les friperies. J’étais quelqu’un de très passionné, relativement dénué d’humour. Mais cela m’a permis de redécouvrir le pouvoir des mots pour comprendre qui j’étais, ce que je pensais, ce en quoi je croyais, et ce qui comptait vraiment pour moi. C’était aussi un moyen de m’y retrouver, de parvenir à interpréter le tourbillon d’événements qui s’enchaînent autour de nous à chaque instant.
Lorsque j’ai obtenu mon diplôme, j’ai décidé que je voulais m’impliquer dans la vie publique. Disons que j’avais de vagues notions de ce que pouvait être l’organisation communautaire… Mais l’idée de continuer à écrire et à raconter des histoires, est restée très importante pour moi. Quand je rentrais du travail, je prenais des notes dans mon journal, ou j’écrivais une histoire ou deux. Cela m’a beaucoup servi dans mon travail communautaire.
Quand j’ai commencé, le type qui m’a engagé m’a expliqué que ce qui donne aux gens le courage de se rassembler pour agir et prendre leurs vies en main, ce n’était pas seulement le fait d’avoir un problème en commun, mais le fait d’avoir des histoires en partage. C’est lui qui m’a dit que, pour être capable de tisser des liens durables avec les gens, il faut apprendre à écouter leurs histoires et à déceler ce qu’elles ont de sacré. Par la suite, ma passion pour le service public et la politique a convergé avec mon intérêt pour les histoires.
A quoi ressemblaient vos nouvelles ?
Je remarque une chose intéressante en les relisant: la plupart parlent de personnes âgées. Je crois que c’est dû, entre autres, au fait que je travaillais dans des communautés composées de gens beaucoup plus âgés que moi. Nous allions dans les églises, où la moyenne d’âge devait être de 55 ou 60 ans.
La plupart de ces gens avaient travaillé d’arrache-pied pour se hisser jusqu’à la classe moyenne, et ils y étaient tout juste parvenus. Ils voyaient peu à peu péricliter les communautés dans lesquelles ils avaient investi leurs espoirs et leurs rêves, au sein desquelles ils avaient élevé leurs enfants – les aciéries avaient fermé, la proportion de Noirs et de Blancs avait beaucoup changé dans ces populations. Il régnait un sentiment de perte et de déception.
Une partie des nouvelles que j’ai écrites évoquait donc ce sentiment, cette atmosphère. Il y en a une sur un vieux pasteur noir menacé de perdre son église, car son bail arrive à expiration. Il a auprès de lui une femme diacre qui lui est fidèle et s’efforce de lui redonner courage. Dans une autre nouvelle, il est question d’un couple âgé – des Blancs de Los Angeles. Lui travaillait dans la publicité, il concevait des jingles. Il vient de prendre sa retraite et cela le rend grincheux. Et sa femme essaie de le convaincre que sa vie n’est pas terminée.
Quand je repense aux sujets qui m’intéressaient, ce n’étaient pas tellement les histoires à la Jack Kerouac, avec des jeunes gens avides de découvertes qui prennent la route et partent à l’aventure… Je préférais les histoires mélancoliques, contemplatives.
Est-ce qu’écrire était aussi une façon de mieux saisir votre identité ?
Oui, je crois. Pour moi, à cette époque en particulier, écrire était une manière de m’y retrouver parmi les nombreux courants opposés qui traversaient ma vie – la race, la classe, la famille. Et je crois sincèrement que cela m’a aidé à intégrer tous les aspects de ce que je suis pour former un tout relativement cohérent.
On me décrit souvent aujourd’hui comme quelqu’un de très posé, maître de lui-même. Et c’est vrai que j’ai globalement un sentiment solide d’appartenance, une vision claire de mon identité et de ce qui compte à mes yeux. C’est en grande partie grâce à cette expérience passée de l’écriture.
Avez-vous continué à écrire pendant que vous étiez président ?
Pas autant que je l’aurais souhaité. Je n’avais tout simplement pas le temps.
Mais vous teniez une sorte de journal ?
J’ai tenu des journaux, oui, mais pas avec autant de discipline que je l’aurais espéré. Quand j’étais président, ma principale activité d’écriture, c’était mes discours – du moins ceux qui m’importaient.
Quel impact a eu sur votre façon d’écrire le fait de rédiger des discours, d’être au cœur de l’histoire et de gérer des situations de crise ?
Je n’en suis pas encore sûr. On verra quand je commencerai à écrire le prochain livre. L’art de composer un bon discours est en partie semblable à toute autre entreprise d’écriture littéraire : tel mot est-il nécessaire ? Est-ce le mot juste ? Est-ce que le rythme fonctionne ? Comment cela sonne-t-il à haute voix ?
En fait, je crois que l’écriture de discours est notamment utile pour se rappeler qu’à l’origine les mots se prononcent, qu’ils ont une sonorité, qu’ils procurent des sensations, même quand on les lit en silence. A cet égard, je crois que je trouverai une forme de continuité. Mais c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles c’était important pour moi, quand j’étais président, de lire un roman de temps en temps : parce que l’essentiel de mes lectures quotidiennes était des documents et notes d’information, des textes de projet.
Et faire travailler en permanence la partie la plus analytique du cerveau peut vous amener à perdre de vue non seulement la poésie de la fiction, mais surtout la profondeur de la fiction. Celle-ci m’était utile pour me rappeler les vérités sous-jacentes aux sujets dont nous débattons tous les jours, et c’était une façon de voir et d’entendre les voix, les multitudes de ce pays.
Avez-vous des exemples de romans ou d’écrivains en particulier ?
Le dernier roman que j’ai lu, c’était The Underground Railroad, de Colson Whitehead (3). Ce livre nous rappelle comment la douleur de l’esclavage se transmet de génération en génération, de façon visible mais aussi plus insidieuse, parce qu’elle transforme les cœurs et les esprits.
Vous avez fait référence à Atticus Finch (4) dans votre discours d’adieu, quand vous avez dit que les gens sont isolés dans leur petite bulle.
La fiction peut rapprocher les gens. J’ai entamé une relation amicale avec Marilynne Robinson (5), qui est aujourd’hui une amie proche. Nous sommes en quelque sorte devenus des correspondants. J’ai commencé à lire son œuvre dans l’Iowa, où se déroulent Gilead et quelques-uns de ses meilleurs romans.
Son travail m’a plu parce que je rencontrais tous les jours les gens dont elle parle dans ses fictions. La vie intérieure qu’elle décrivait, que ces gens partageaient – ces gens à qui je serrais la main et à qui j’adressais mes discours –, cette vie intérieure les liait aussi à mes grands-parents, qui étaient du Kansas et ont fini leur vie à Hawaï, mais avaient leurs racines dans un univers très semblable.
Pendant mon mandat, j’ai pu imaginer plus facilement ce qui se passait dans la vie des gens, non pas grâce à un roman en particulier, mais grâce au fait de lire de la fiction. C’est une forme d’entraînement, et je pense qu’elle a été utile. Et puis il y avait parfois des moments où j’avais seulement besoin d’échapper à moi-même. Parfois on lit de la fiction simplement parce qu’on a envie d’être ailleurs.
Avez-vous des exemples de livres de ce genre ?
C’est amusant car finalement pour m’évader je lis toutes sortes de genres littéraires – de la science-fiction, notamment. Pendant un moment, il y avait une trilogie de romans de science-fiction, la série intitulée Le Problème à trois corps (6)…
Oh, de Liu Cixin, qui a gagné le prix Hugo.
C’est d’une imagination folle, très intéressant. Il ne s’agit pas tant d’études de personnages que de cette question fondamentale…
En fait cela parle du destin de l’univers.
Exactement. C’est d’une portée vertigineuse. Et tellement amusant à lire, entre autres parce qu’après cela mes difficultés quotidiennes avec le Congrès paraissaient assez insignifiantes. Pas de quoi s’inquiéter: les extraterrestres sont sur le point de nous envahir. Il y a aussi ces livres qui associent, selon moi, une véritable plume à la littérature de genre, comme le thriller.
Par exemple, je trouve que Les Apparences (7) est un livre bien construit, bien écrit. La structure narrative m’a beaucoup plu. Dans le même genre, en termes de structure, il y a un roman que j’ai trouvé très puissant : Les Furies, de Lauren Groff (8). J’aime bien ces constructions qui vous permettent de découvrir différents points de vue. C’est ce que je devais faire moi aussi dans ce boulot.
Y a-t-il des livres qui sont devenus des références pour vous, au cours de ces huit années ?
Je dirais que Shakespeare reste une référence. Comme la plupart des adolescents au lycée, quand on nous a donné à lire La Tempête, je me suis dit : « Oh mon Dieu, qu’est-ce que c’est ennuyeux ! » Et puis, j’ai suivi un cours formidable sur Shakespeare à l’université, et je me suis mis à lire les tragédies et à approfondir son œuvre. Et je crois que cela a été fondateur pour moi, pour comprendre comment certains comportements se répètent, et ce qui se joue entre les êtres humains.
Est-ce que cela vous rassure, en quelque sorte ?
Cela me permet de mettre les choses en perspective. Je pense aux œuvres de Toni Morrison – Le Chant de Salomon (9) tout particulièrement, un livre qui me vient en tête quand je me représente des gens qui traversent des moments difficiles. Je me dis qu’il ne s’agit pas que de souffrance, mais aussi de joie, de gloire et de mystère. Il y a des écrivains avec lesquels je ne suis pas forcément d’accord sur le plan politique, mais dont les œuvres m’offrent en quelque sorte un contrepoint sur lequel m’appuyer pour penser certains sujets : V.S. Naipaul, par exemple.
Son livre A la courbe du fleuve (10) s’ouvre avec la phrase suivante : « Le monde est ce qu’il est ; les hommes qui ne sont rien, qui s’autorisent à ne rien devenir, n’y ont pas leur place. » Je repense toujours à cette phrase et aux romans de Naipaul quand je médite sur la brutalité du monde, notamment en matière de politique étrangère. Et je résiste, je me bats contre cette vision cynique et réaliste du monde. Et pourtant, il arrive parfois que cette phrase ait des accents de vérité. En ce sens, des textes comme celui-là me servent de repoussoirs, ce sont des points de vue contre lesquels on peut débattre. […]
Avez-vous des livres à recommander en cette période que nous traversons, qui ont su saisir le chaos ambiant ?
C’est probablement à vous que je devrais poser la question. Je dois avouer que depuis les élections, j’ai été plus occupé que je ne m’y attendais. L’une des choses que j’ai vraiment hâte de faire, c’est de me plonger dans quantité de livres. Mais ce dont je suis sûr, c’est qu’il y a un tas d’écrivains, jeunes pour la plupart, qui sont probablement en train de se saisir de ce moment pour écrire le livre que j’ai besoin de lire. Ils ont une longueur d’avance sur moi, aujourd’hui.
Et dans cette période post-présidence, en plus de former la prochaine génération de dirigeants à travailler sur des questions comme le changement climatique, la violence armée ou la réforme du système de justice pénale, j’espère parvenir à créer des liens entre eux et leurs pairs qui considèrent la fiction ou la non-fiction comme un élément important de ce processus.
Alors que l’essentiel de la politique consiste à essayer de gérer le choc des cultures provoqué par la mondialisation, la technologie et les migrations, le rôle des histoires pour unifier plutôt que pour diviser, pour impliquer plutôt que pour marginaliser, est plus crucial que jamais.
Il y a quelque chose d’unique dans le fait de ralentir et de s’accorder un temps long, qui n’est pas celui de la musique, de la télévision ou des films, même les meilleurs. Or de nos jours, nous sommes tous confrontés à une masse d’informations, et nous manquons de temps pour les assimiler. Cela nous conduit à formuler des jugements trop rapides, à traiter les choses de façon stéréotypée ou à en refouler d’autres, simplement parce que notre cerveau fait ce qu’il peut pour tenir le coup. […]
Je sais que vous aimez les livres de Junot Diaz et de Jhumpa Lahiri, qui interrogent les thèmes de l’immigration, ou encore du rêve américain.
Pour moi, leurs romans témoignent en effet d’une forme bien précise d’expérience contemporaine de l’immigration. Mais ils parlent aussi de ce mélange de sentiments que je crois universel : l’aspiration à un avenir meilleur, ailleurs, en même temps que l’impression de ne pas être à sa place, et la nostalgie du passé. En ce sens, je crois que leurs romans entretiennent un lien direct avec une grande partie de ce qui constitue la littérature américaine.
Certains des plus grands livres d’auteurs juifs comme Philip Roth ou Saul Bellow sont pétris de ce sentiment d’être un étranger, de cette aspiration à s’intégrer, sans être certain de ce qu’il faudra abandonner en retour – de ce qu’on est prêt ou pas à abandonner. Cette facette particulière de la fiction américaine est, je crois, toujours d’une grande actualité.
(1) Barack Obama, né en 1961 à Hawaï, a vécu quatre années en Indonésie, pays d’origine de son beau-père, entre 1967 et 1971.
(2) Son autobiographie publiée en 1995.
(3) Publié en 2016 et récompensé par le National Book Award, à paraître le 17 août 2017 chez Albin Michel.
(4) Atticus Finch est l’un des personnages principaux de Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur (1960), de Harper Lee, avocat blanc défenseur de la cause des Noirs.
(5) Romancière née en 1943, auteur entre autres de Gilead (2004) et Chez nous (2009).
(6) Publié en 2016.
(7) Roman de Gillian Flynn publié en 2012 et adapté au cinéma en 2014 par David Fincher.
(8) Publié en 2015.
(9) Publié en 1977.
(10) Publié en 1979







 "Impressions" de Sada Kane avec El Hadji Gassama (ElGas) auteur de "Un Dieu et des mœurs"
"Impressions" de Sada Kane avec El Hadji Gassama (ElGas) auteur de "Un Dieu et des mœurs"